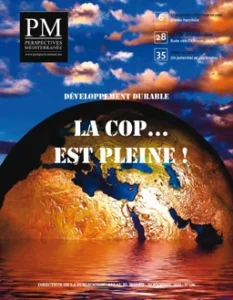L’Algérie a profité de cette tribune internationale pour inscrire la question du Sahara à l’ordre du jour de la réunion. Après avoir constaté l’« échec du Conseil de sécurité à imposer à Israël de mettre fin à l’escalade » au Moyen Orient, le ministre algérien des Affaires étrangères a abordé la situation en Afrique. « Les développements et les tensions qui surviennent dans la région sahélo-saharienne alimentent l’anxiété et n’inspirent aucune confiance. En témoigne le conflit en cours dans la dernière colonie africaine du Sahara occidental », a souligné Ahmed Attaf.
A l’affut, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a réagi en condamnant certains « Etats membres » du Conseil de sécurité qui « financent et accueillent des milices armées qui menacent la stabilité des territoires d’Etats voisins ». Une collusion qui, selon le responsable marocain, « constitue également une violation des principes de la Charte des Nations unies ».
Dans un message adressé, en avril 2018, au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le roi Mohammed VI avait indiqué que « l’Algérie a une responsabilité flagrante. C’est l’Algérie qui finance, c’est l’Algérie qui abrite, c’est l’Algérie qui arme, c’est l’Algérie qui soutient et qui apporte son soutien diplomatique au Polisario ».
L’Algérie qui prépare le Forum annuel de soutien au Polisario à Oran a tenté de faire les bouchées doubles à New-York, en marge de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies. A. Attaf a convié pour une réunion, ses homologues du Mozambique, de la Sierra Leone, de la République de Guyana, membres non-permanents du Conseil de sécurité. La Somalie, dont le mandat au sein de l’instance exécutive de l’ONU commencera le 1er janvier 2025, a également été invitée.
Officiellement la rencontre a permis aux parties de « renouveler l’engagement de poursuivre les consultations régulières et la coordination étroite sur les différentes questions à l’ordre du jour du Conseil de sécurité », indique la diplomatie algérienne dans un communiqué.
Sur la liste des invités de l’Algérie, trois pays soutiennent la marocanité du Sahara, à savoir : la Somalie, la République de Guyana et la Sierra Leone. En revanche, l’Algérie et le Mozambique reconnaissent la fantomatique RASD. Bien avant son mandat à l’instance exécutive de l’ONU, Alger avait l’habitude d’organiser à Oran un forum de soutien au Polisario, avec la participation de pays africains, notamment les membres non-permanents du Conseil de sécurité.
Cette réunion s’est tenue à quelques semaines de l’examen par les Quinze d’une nouvelle résolution devant prolonger le mandat de la MINURSO au Sahara occidental pour une année supplémentaire. L’Algérie se mobilise en coulisses pour convaincre des pays de voter contre ou d’opter, au moins, pour l’abstention lors de l’adoption du texte, prévue fin octobre.
Madrid garde le cap marocain
A noter que lechef du gouvernement espagnol a déçu le Polisario et l’Algérie. Leurs médias ont passé sous silence l’intervention du Premier ministre espagnol à l’Assemblée générale de l’ONU. Et pour cause ! A la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, Pedro Sanchez a affirmé que « l’Espagne continuera à soutenir l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour parvenir à une solution mutuellement acceptable dans le cadre de l’Organisation », rapporte la présidence de l’exécutif dans un communiqué.
P. Sanchez a de nouveau fait l’impasse sur le « droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental » et « l’organisation d’un referendum » au Sahara. Il faut remonter à son intervention devant l’Assemblée générale de l’ONU de septembre 2018 pour retrouver ces marqueurs de la position du Polisario.
Pour rappel, la Déclaration conjointe du 7 avril 2022, sanctionnant les entretiens entre le roi Mohammed VI et P. Sanchez, dispose en effet que « l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend ». Depuis, P. Sanchez n’a eu cesse de réitérer sa position.