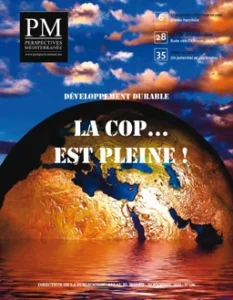« L’Algérie est prête à discuter » avec les États-Unis d’un accord concernant ses ressources naturelles et minérales, avait déclaré Sabri Boukadoum, ambassadeur algérien à Washington, lors d’une interview accordée à un média américain. « Nous cherchons à mettre en avant notre potentiel auprès de la nouvelle administration. Avec le président Trump, qui a manifesté son intérêt pour les accords, nous espérons convaincre l’administration des avantages d’une collaboration avec l’Algérie », avait précisé le diplomate.
Pour gêner aux entournures le Royaume, Alger aurait mis dans la balance la mine de fer de Gara Djebilet, située à Tindouf. Un proche de l’actuel hôte de la Maison Blanche aurait été affranchi dans ce sens. En échange, le système algérien espère une suspension de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara ou, à tout le moins, la continuation de la politique du président Joe Biden sur cette question. Les États-Unis ont réitéré, mardi 8 avril, leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, initialement proclamée par le président Donald Trump le 10 décembre 2020.
Longtemps revendiqué par le Maroc, le roi Hassan II et le président Houari Boumediene avaient signé, le 15 juin 1972 à Rabat, un accord sur le tracé des frontières, publié dans le Journal officiel de la République algérienne le 15 juin 1973. Cependant, le royaume n’a officialisé cette procédure que par un dahir royal le 22 juin 1992. Plus, les deux chefs d’État avaient également conclu « une convention de coopération pour la mise en valeur de la mine de Gara Djebilet, afin d’établir une paix durable pour les siècles à venir », partageant le gisement à 50 % pour chaque pays. Cependant, malgré les nombreuses tentatives de Rabat pour amener Alger à respecter ses engagements, le projet est tombé en désuétude. Jusqu’au 30 mars 2021, lorsque l’exploitation des réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes a été confiée à un consortium composé de trois sociétés chinoises. Le gisement de fer de Gara Djebilet se classe au deuxième rang mondial, derrière l’Australie (avec 5,1 milliards de tonnes).