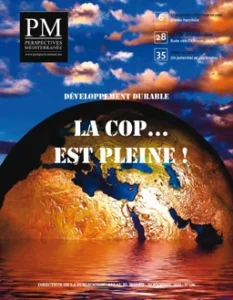Présidée par le directeur de la Géologie, Mohamed Ben Lakhdim, ladite réunion convoquée mardi dernier a recommandé « une révision de la carte des zones sismiques spécifiques en conformité avec la réglementation parasismique en vigueur, ainsi que l’établissement de cartes précises des zones présentant des déformations en surface », à la lumière du tremblement de terre dont l’épicentre se trouve dans le Haouz.
Le comité scientifique a souligné, à cette occasion, l’importance « d’intégrer les données géoscientifiques disponibles à toutes les étapes de la planification de la reconstruction des zones sinistrées ». Comme il a recommandé de prendre en compte ces données lors du choix des emplacements des stations de mesure sismique que le Centre national de recherche scientifique et technique installera au cours des différentes phases de reconstruction des zones touchées.
Cette réunion, la première de son genre depuis le violent séisme, a rassemblé plusieurs professeurs et experts dans le but d’analyser les causes et les conséquences du séisme d’Al Haouz. Leur diagnostic du contexte géologique de la région a révélé qu’elle a été le théâtre de nombreux événements et phénomènes sédimentaires et structurels. La région se caractérise par des reliefs escarpés où se côtoient des sommets dépassant les 2500 mètres d’altitude ainsi que des vallées profondes. Elle est également géologiquement structurée en trois types de failles : les failles de premier ordre, « parallèles aux montagnes de l’Atlas nord et sud », les failles de deuxième ordre, orientées NE-SW comme la faille de Tizi N’Test et la faille d’Erdoz, et les failles de troisième ordre présentant deux directions E-W et WNW-ESE, comme la faille d’Aghbar et la faille d’Oukdamt.
Les données publiées par l’US Geological Survey et le Centre national de recherche scientifique et technique laissent augurer que « les failles de troisième ordre pourraient être la principale cause de cette activité sismique ». Ces mêmes données indiquent que l’ampleur considérable de ces failles et leur faible inclinaison expliquent « la magnitude du séisme », tout en notant que « les failles de premier et deuxième ordres pourraient également avoir connu une activité parallèle, mais de moindre importance ».
Le Comité a enfin indiqué que la présence d’une épaisse couche de roches datant du milieu du Cambrien, connue sous le nom de « schistes à Paradoxides », « pourrait jouer un rôle crucial dans l’atténuation de la force de ce séisme ».