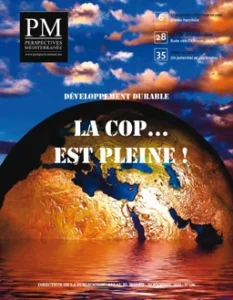D’après le média allemand, Kiev craint que D. Trump puisse accepter de céder à la Russie des territoires que les troupes russes ne contrôlent pas encore. La Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne craignent un possible retrait des troupes US d’Europe et « une offensive de l’armée russe d’ici quelques années ». Lors d’un briefing à Bruxelles, Stefan De Keersmaecker, porte-parole de la Commission européenne, a déclaré que l’UE attendait une « paix juste et durable » en Ukraine de la conversation entre les présidents américain et russe. Il a ajouté que l’Ukraine faisait partie de cette solution et des pourparlers de paix.
Bild a également souligné que Paris et Londres se préparaient au pire des scénarios. Par conséquent, leur projet d’envoyer des soldats de la paix contre la volonté de Moscou « prend de plus en plus forme ». Si D. Trump « jette l’Ukraine sous le train », les pays de l’UE pourraient intervenir. Un tel revirement conduirait alors à une « confrontation entre Moscou et Washington ».
La conversation téléphonique entre V. Poutine et D. Trump prévue mardi, comme l’a rapporté le président américain sur le réseau social TruthSocial aurait conduit le Kremlin à accepter de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine pour 30 jours. La Russie a informé les États-Unis de ses conditions pour une trêve, parmi lesquelles l’arrêt de l’aide occidentale à Kiev, laisse-t-on entendre. Le dialogue entre les chefs d’État russe et américain devait principalement s’axer sur le règlement du conflit en Ukraine. D. Trump avait souligné que de nombreux points de l’accord final ont été validés mais il reste encore beaucoup à accomplir. Le Kremlin a confirmé que l’entretien téléphonique se déroulerait entre 16 et 18 heures, heure de Moscou. Dmitri Peskov, porte-parole du président russe, a toutefois précisé que la conversation entre les présidents russe et américain pourrait durer aussi longtemps que les dirigeants le jugeraient nécessaire. « Nous suivons la voie du rétablissement des relations bilatérales et de divers modes de dialogue à différents niveaux. C’est une étape extrêmement importante qui donne le ton au reste du mouvement », a-t-il déclaré aux journalistes.
L’administration Trump envisage de reconnaître officiellement la péninsule de Crimée comme territoire russe dans le cadre d’un accord sur un règlement pacifique du conflit en Ukraine, a rapporté le site américain Semafor, citant des sources proches du dossier. Selon le site, les autorités américaines étudient également la possibilité de demander à l’ONU de suivre une démarche similaire. Semafor précise toutefois que le président américain n’avait pas encore pris de décisions et que celles proposées sur la Crimée n’étaient que des options parmi d’autres. La Maison Blanche n’a pas non plus confirmé cette information au site. Volodymyr Zelensky a déclaré en novembre dernier que Kiev pourrait restituer la Crimée par la voie diplomatique, mais pas sur le plan militaire. Il a ajouté que l’Ukraine ne reconnaîtrait pas comme russes les territoires « occupés » depuis 2014. La Crimée a été rattachée à la Russie à la suite d’un référendum en 2014, et le président russe a déclaré que la question de l’appartenance territoriale de la péninsule était réglée. Il a clairement spécifié que la reconnaissance internationale de la Crimée et des nouvelles régions – les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporojié – était l’une des conditions nécessaires à l’ouverture de pourparlers de paix sur le conflit en Ukraine.
Par ailleurs, le 17 mars, les États-Unis ont officiellement annoncé leur retrait du Centre international d’enquête sur les crimes contre l’Ukraine, a rapporté le New York Times. Ce centre, basé à La Haye et supervisé par Eurojust, avait pour mission d’enquêter sur l’opération militaire russe en Ukraine. Washington, qui avait rejoint cette initiative en 2023 sous l’administration Biden, a informé les responsables européens de son retrait par un message confidentiel avant de l’officialiser. L’administration américaine justifie ce choix par une réaffectation des ressources du ministère de la Justice.
Selon RBC Russia, les États-Unis réduisent également leur coopération avec l’Ukraine sur les enquêtes en cours, notamment en mettant fin à la mission d’un procureur américain qui travaillait avec des enquêteurs ukrainiens et européens à La Haye. Ce retrait marque une évolution dans la position de Washington, qui avait jusqu’à présent maintenu une participation active dans cette structure.
Avec l’arrivée de D. Trump à la Maison-Blanche, plusieurs engagements pris sous l’administration Biden ont été remis en question. Selon l’agence TASS, la décision de quitter le groupe d’enquête découle d’une volonté de recentrer la politique étrangère sur d’autres priorités stratégiques. En parallèle, le ministère américain de la Justice réduit également l’activité de son équipe spécialisée dans les crimes en Ukraine, créée en 2022 sous l’administration Biden. Selon le NYT, cette unité avait notamment pour mission d’assister les procureurs ukrainiens et de coordonner les efforts américains en matière de poursuites judiciaires. Sous l’administration Trump, cette coopération est désormais limitée.
Depuis son retour à la présidence en janvier dernier, D. Trump a placé en priorité la résolution du conflit en Ukraine via l’ouverture de pourparlers de paix. Il a déclaré que les chances de parvenir à une issue négociée étaient « très bonnes ». Cette approche marque un tournant par rapport à la stratégie de l’administration Biden, qui privilégiait le soutien militaire et judiciaire à l’Ukraine. Selon Interfax, le retrait américain du groupe d’enquête pourrait modifier l’équilibre des investigations en cours. L’Union européenne, qui continue de soutenir cette initiative, devra désormais poursuivre ses efforts sans la participation de Washington. Ce choix souligne les différences d’approche entre les États-Unis et leurs alliés européens quant à la manière de traiter les questions liées au conflit en Ukraine.
Paris s’agite
En parallèle, Emmanuel Macron s’est rendu mardi sur la base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, site stratégique pour la défense aérienne française. Selon Le Figaro, cette base est un élément clé du dispositif français et est qualifiée de « police du ciel », qui intervient tant sur le territoire national que dans l’espace aérien des alliés de l’OTAN. Lors de son discours, le président français a annoncé que 1,5 milliard d’euros allaient être investis pour moderniser la base et adapter ses infrastructures. Ce projet prévoit l’accueil de deux escadrons de Rafale, ce qui va doubler le format de la base et porter le nombre de militaires et civils présents à près de 2 000 d’ici 2035. Ce plan aura aussi des répercussions sur la région, avec l’arrivée de plusieurs milliers d’habitants supplémentaires.
Ce renforcement s’inscrit dans une politique plus large de réarmement. E. Macron a insisté sur la nécessité pour la France d’augmenter ses capacités militaires face à un environnement international qu’il qualifie de « plus dangereux et incertain ». Le chef de l’État a déclaré que « l’armée française est à coup sûr l’armée la plus efficace du continent ». L’une des annonces les plus marquantes concerne le retour de la dissuasion nucléaire sur la base de Luxeuil. Après le retrait des forces nucléaires en 2011, des Rafale équipés de missiles nucléaires hypersoniques seront stationnés sur la base dès 2035. Cette décision, qui marque une évolution importante de la posture militaire française, est présentée par l’Élysée comme une réponse aux tensions croissantes en Europe. Cette annonce s’inscrit également dans un contexte où la France tente de repositionner sa stratégie militaire au sein de l’Europe, notamment en raison de la politique étrangère incertaine des États-Unis.
D’après Le Figaro, Paris cherche ainsi à consolider son rôle dans la défense des intérêts de l’OTAN, en mettant en avant son arsenal nucléaire comme un facteur de dissuasion. Emmanuel Macron a insisté sur l’importance de cette modernisation pour assurer la protection du territoire français. « Si nous voulons éviter la guerre, nous devons nous doter des moyens nécessaires pour nous défendre », a-t-il affirmé tout en insistant sur le fait que la France devait continuer à investir dans ses capacités militaires et à renforcer la souveraineté de sa défense.
L’idée d’E. Macron d’envoyer une force française en Ukraine, même pour garantir une paix éventuelle, n’est pas réaliste, a déclaré à Sputnik Afrique Jacques-Marie Bourget, rappelant que « Soldat et paix, c’est deux mots qui se marient assez mal ».
« J’ai vu souvent sur le terrain, le plus souvent au Liban avec la FINUL, la situation de ces pauvres garçons de l’Onu avec le béret bleu, qui étaient principalement de la chair à canon […]. Les soldats français qui iraient en Ukraine pour garantir la paix, ils viendraient tout simplement en renfort de l’armée ukrainienne. L’armée française vient d’être chassée de l’Afrique de l’Ouest d’une façon assez lamentable. Avec du matériel pour partie en révision ou en panne et une armée qui est faible, je ne vois pas quel rôle sur le terrain pourrait jouer les troupes françaises », a indiqué le journaliste français.
Si le Président français insiste sur ce point, malgré les mises en garde de Moscou, c’est qu’il cherche à prendre la lumière, poursuit le journaliste. « La seule explication est d’ordre psychologique. Emmanuel Macron ne peut s’empêcher de jouer l’important. Bientôt, il va faire comme Zelensky et porter un t-shirt kaki. Il a aussi des conseillers très intéressés à partager quelque chose financièrement en Ukraine, à avoir une petite part du gâteau, s’il en reste », affirme-t-il.
Cette opération de communication a fait monter E. Macron dans les sondages, mais ne signifie pas que les Français sont prêts à la guerre avec Russie, ajoute J-M. Bourget. « Il a pris cinq à six points de popularité. Mais la semaine prochaine, on peut faire un sondage en demandant aux gens s’ils sont prêts à ce que leurs fils de 20 ans partent faire la guerre contre la Russie et je suis sûr que ce sondage prendra un chemin complètement différent. On est dans le grotesque. Qui veut faire la guerre à la Russie? », conclut-il.
Avancée russe à Zoporojié
Sur le théâtre des opérations à proprement parler, les forces russes ont libéré la localité de Stepovoїé dans la région de Zaporojié et renforcé leurs positions sur la ligne de front, a annoncé lundi la Défense russe dans son bilan quotidien de l’opération spéciale.
Le groupement Nord a attaqué deux brigades ennemies dans la région de Kharkov. Les forces ukrainiennes ont perdu 90 militaires et 18 véhicules. Un dépôt de munitions a été détruit.
Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, attaquant trois brigades ukrainiennes dans la région de Kharkov et en république populaire de Donetsk (RPD). L’armée de Kiev a perdu 225 militaires, une pièce d’artillerie et trois stations de guerre électronique.
Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses en RPD. Il a attaqué quatre brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 190 militaires et une pièce d’artillerie. Un dépôt de munitions de campagne a été anéanti.
Le groupement Centre ont continué à avancer dans la profondeur de la défense ennemie en RPD. Il a attaqué deux brigades ukrainiennes. Les pertes de l’armée de Kiev s’élèvent à 495 militaires, quatre blindés de combat, dont un véhicule de combat d’infanterie Bradley américain, trois pièces d’artillerie et deux stations de guerre électronique.
Le groupement Est a attaqué trois brigades ukrainiennes en RPD. Les pertes de l’ennemi s’élèvent à 140 militaires et deux véhicules de combat blindés.
Le groupement Dniepr a libéré la localité de Stepovoїé dans la région de Zaporojié. Il a attaqué deux brigades ennemies dans les régions de Zaporojié et de Kherson. Les forces ukrainiennes ont perdu 65 militaires et une station de guerre électronique.
La défense aérienne russe a abattu deux bombes aériennes guidées JDAM américaines et 177 drones à voilure fixe.