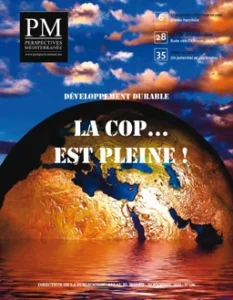Signée par une vingtaine de rescapés et témoins du génocide, ainsi que deux associations, Rwandais Avenir et le Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR), une requête avait été déposée en avril 2023 devant le tribunal administratif de Paris, reprochant à la France une « complicité de fait » dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Le tribunal administratif de Paris a examiné le 24 octobre la requête de ces victimes qui espèrent voir l’État français reconnu coupable de « faute systémique » dans son soutien présumé au gouvernement hutu et de manquements lors des opérations françaises telles qu’Amaryllis et Turquoise.
Selon la presse française, qui cite les requérants, il s’agit de la première action intentée devant la justice administrative, qui intervient après de multiples tentatives sans succès devant les juridictions pénales. Représentés par Serge Lewisch, les requérants ont souligné vouloir établir « le caractère gravement fautif et systémique d’une série d’actes manifestement illégaux » qu’aurait commis la France entre 1990 et 1994.
La plainte accuse l’État français d’avoir entretenu un soutien continu, à la fois politique, militaire et diplomatique aux extrémistes hutus, responsables du massacre de plus de 800 000 personnes, principalement issues de la minorité tutsie, selon les estimations de l’ONU, ont rapporté les médias français. « L’État français pouvait éviter ce génocide mais il n’a rien fait », a précisé l’avocat, soulignant que son soutien aux extrémistes hutus avait été continu « avant, pendant et après le génocide ». Les requérants reprochent notamment à la France de ne pas avoir révoqué son traité d’assistance militaire avec le Rwanda, datant de 1975, malgré les dérives racistes et génocidaires du gouvernement hutu alors en place.
Accusés d’avoir déséquilibré le pouvoir en faveur d’une autorité militaire au détriment du contrôle civilo-politique, l’ancien secrétaire général de l’Élysée, Hubert Védrine, ainsi que plusieurs militaires de haut rang, notamment l’amiral Jacques Lanxade, chef d’état-major des armées de 1991 à 1995, sont également concernés par cette action.
Du 7 avril au 17 juillet 1994, des tueries ont été déclenchées au lendemain de l’attentat contre l’avion du président hutu Juvénal Habyarimana, relançant la guerre civile qui avait fait rage entre Hutus et Tutsis de 1990 et 1993. Trois mois durant, l’armée et les milices hutues, mais aussi de simples citoyens ont massacré, souvent à la machette, les Tutsis, qualifiés de « cafards ».
Les requérants, représentés par Philippe Raphaël, soulignent vouloir établir « le caractère gravement fautif et systémique d’une série d’actes manifestement illégaux » commis par la France entre 1990 et 1994, permettant aux extrémistes hutu de massacrer plus de 800 000 personnes, principalement issues de la minorité tutsi, selon les estimations de l’ONU.
Parmi les accusations, les plaignants reprochent à la France de ne pas avoir révoqué son traité d’assistance militaire avec le Rwanda, datant de 1975, malgré les signes évidents de dérive génocidaire du régime en place. Si la justice pénale a classé cette affaire sans suite en octobre 2023, estimant qu’il n’existait pas de preuves d’une implication directe des forces françaises dans les massacres de civils réfugiés dans les collines de Bisesero, les parties civiles ont fait appel de cette décision. La cour d’appel de Paris doit statuer sur cet appel le 11 décembre prochain.
Enfin, les requérants s’appuient sur le rapport de la commission d’historiens présidée par Vincent Duclert, qui avait conclu en 2021 à des responsabilités « lourdes et accablantes » de la France dans ce drame, bien qu’écartant toute complicité directe de génocide. Pendant plusieurs mois, des campagnes d’extermination se sont succédé, tandis que la communauté internationale, malgré de nombreux signes précurseurs, a tardé à intervenir pour protéger les civils.