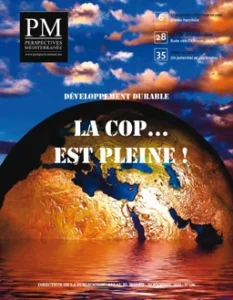L’objectif de cette nouvelle édition est de répondre à plusieurs questions essentielles : qui pose le plus de questions : la majorité ou l’opposition ? Les nouveaux député.e.s sont-ils plus actifs que les réélu.e.s ? Et quelle est l’influence de la présidence d’un groupe parlementaire sur la réactivité des député.e.s ? De plus, quels ministères répondent le plus aux questions posées par les parlementaires ?
Les résultats révèlent des tendances contrastées concernant l’activité des député.e.s et la réactivité du gouvernement. Sur un total de 3.202 questions posées durant cette session, le gouvernement n’a répondu qu’à 19 % d’entre elles. Cette situation soulève des interrogations sur l’engagement du gouvernement face aux préoccupations soulevées par les élu.e.s.
Le rapport met en évidence que les ministères de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, ainsi que de la Santé et de la Protection sociale, sont ceux qui reçoivent le plus de questions. Le premier a ainsi reçu 308 questions, dont 102 ont été répondues, soit environ 33 % du total, avec 10 % comportant des engagements gouvernementaux. Idem pour le second qui a également reçu 308 questions, avec 61 réponses fournies, dont 7 avec des engagements. Il convient de noter une forte baisse du taux de réponse de ce ministère par rapport aux quatre premières sessions, passant de 56 % à seulement 2 %.
Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts arrive en troisième position avec 307 questions et un taux de réponse de 18 %. Ce classement souligne la prédominance des questions sociales au sein de l’hémicycle, reflet des préoccupations croissantes de la population durant cette période.
Le même rapport indique que les grèves répétées des enseignants, ayant duré plus de trois mois, témoignent d’un intérêt croissant et d’une préoccupation réelle vis-à-vis des conséquences de ces grèves sur les élèves, ainsi que des sanctions imposées aux enseignants participants.
Concernant le secteur de la santé, les questions liées à la réforme du système de couverture sanitaire et de protection sociale, ainsi que les grèves des étudiants des facultés de médecine, sont parmi les préoccupations majeures soulevées. Les inquiétudes liées à la sécheresse, à la rareté des précipitations et à la baisse du niveau des ressources en eau dans les barrages sont également des sujets d’intérêt pour les députés.
Malgré l’importance manifeste de ces préoccupations, la réponse du gouvernement aux questions parlementaires demeure insuffisante, atteignant seulement 19 % des questions posées. Au total, durant la cinquième session de la législature 2021-2026, les député.e.s ont posé 3.202 questions, et le gouvernement n’a répondu qu’à 610 d’entre elles.
Les questions orales représentent 53 % du total, avec 1.702 questions posées. Les membres du parlement montrent une préférence pour ce format, bien que celui-ci soit limité par le temps accordé à chaque groupe, tandis que les questions écrites, sans contraintes de temps, permettent aux député.e.s de s’exprimer plus librement.
Ce rapport met en lumière les dynamiques politiques, géographiques et les profils des député.e.s les plus actifs au sein de la Chambre des Représentants, tout en révélant des changements significatifs par rapport à la première édition. « Tafra » avait consacré sa première édition à l’analyse des données relatives aux questions parlementaires posées durant les quatre premières sessions de la législature 2021-2026.