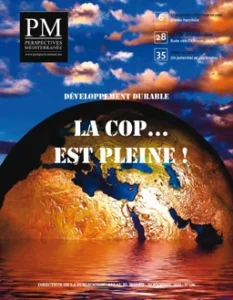Selon le rapport du SIPRI publié lundi sur les « Tendances des dépenses militaires mondiales », les budgets militaires en Afrique se sont élevées à 52,1 milliards de dollars en 2024, dont 30,2 milliards dépensés en Afrique du Nord. Dans ce contexte, un expert en sécurité a souligné dans une déclaration à la presse que la part prépondérante des deux pays maghrébins dans les dépenses militaires africaines s’explique par « une course à l’armement continue depuis plus de dix ans ».
Il a souligné que cette dynamique de surenchère militaire « nécessite naturellement l’allocation de budgets considérables par chaque État et la mobilisation d’une part importante du trésor public pour l’acquisition de divers types d’équipements, notamment du matériel militaire sophistiqué », entraînant ainsi une hausse continue des dépenses militaires. Ce processus vise, selon lui, la modernisation et le développement des arsenaux, en particulier dans le domaine de l’aviation.
Compte tenu de sa position géographique, bordée par deux façades maritimes de plus de 3.500 kilomètres, l’expert souligne que le Maroc œuvre également au renforcement de sa marine militaire à travers l’acquisition de frégates, de navires de guerre et de missiles, tout en explorant la possibilité d’acheter des sous-marins, notamment auprès de la France ou de l’Allemagne.
De son côté, l’Algérie a enregistré une hausse de 12 % de ses dépenses militaires, soutenue par les revenus issus des hydrocarbures, atteignant ainsi 21,8 milliards de dollars en 2024, selon le rapport du SIPRI. L’Algérie demeure ainsi le premier dépensier militaire du continent africain, son budget militaire représentant 21 % des dépenses publiques totales. À ce sujet, l’expert indique que l’Algérie poursuit également ses efforts de modernisation de son arsenal, à travers l’acquisition de chasseurs de cinquième génération, de drones et de systèmes de missiles récents.
Cependant, la principale différence entre les deux pays, précise l’expert, réside dans la stratégie d’approvisionnement : le Maroc mise sur la diversification de ses sources d’armement, s’approvisionnant auprès de plusieurs partenaires, notamment les États-Unis et la France — auprès de laquelle il a acheté deux satellites destinés à la surveillance régionale — mais également en s’ouvrant à des pays émergents comme la Turquie, le Pakistan ou encore l’Inde. L’Algérie, quant à elle, continue de dépendre essentiellement de l’industrie militaire russe, ce qui la rend plus vulnérable à la dépendance vis-à-vis d’une seule source.
Après deux années consécutives de baisse, le Maroc a relevé ses dépenses militaires de 2,6 % en 2024, atteignant 5,5 milliards de dollars. Le rapport du SIPRI attribue cette augmentation principalement à la hausse des dépenses consacrées aux ressources humaines militaires.
Par ailleurs, le SIPRI indique que les dépenses militaires totales en Afrique ont atteint 52,1 milliards de dollars en 2024, enregistrant une hausse de 3 % par rapport à 2023, et de 11 % par rapport à 2015.
Le rapport précise que l’Afrique du Nord, à elle seule, a déboursé 30,2 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 8,8 % par rapport à l’année précédente et une progression impressionnante de 43 % par rapport à 2015.
En revanche, les dépenses militaires des pays d’Afrique subsaharienne ont diminué pour atteindre 21,9 milliards de dollars, soit une baisse de 3,2 % par rapport à 2023 et de 13 % par rapport à 2015.
Le rapport attribue principalement ce recul à la diminution des budgets militaires en Afrique du Sud, au Nigeria et en Éthiopie. L’Afrique du Sud, principal contributeur de la région, a continué pour la quatrième année consécutive de réduire ses dépenses militaires, les ramenant à 2,8 milliards de dollars, en conformité avec sa stratégie budgétaire axée sur la promotion de la croissance économique et le développement des services sociaux.
En revanche, les pays du Sahel ayant connu des coups d’État récents ont vu leurs dépenses militaires augmenter de manière notable. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont alloué ensemble environ 2,4 milliards de dollars à la défense en 2024. Durant la période 2020–2024, les dépenses militaires du Mali ont progressé de 38 %, celles du Burkina Faso ont bondi de 108 % entre 2021 et 2024, et celles du Niger ont grimpé de 56 % entre 2022 et 2024. La Tchad, de son côté, a annoncé en 2024 la fin de sa coopération militaire avec la France et a augmenté ses dépenses militaires de 43 %, atteignant 558 millions de dollars, ce qui a porté la part de son budget militaire à 3 % du PIB, soit la plus forte progression relative enregistrée sur le continent cette année-là.