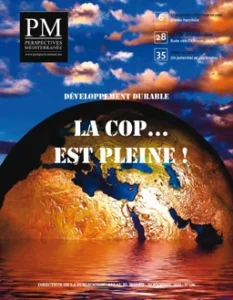Tout au long de la semaine, les deux pays ont multiplié messages et mises en garde : affichage de bonne volonté mais aussi menaces avant d’entamer ces premières discussions sous l’ère Trump. Avec la réélection de Donald Trump, le chef du gouvernement israélien nourrissait l’espoir de retrouver son grand allié dans son combat contre l’Iran. Lors de son premier mandat, le républicain avait pris le contrepied de son prédécesseur démocrate qui avait signé l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Pendant toute la campagne électorale de 2016, il n’avait eu de cesse de dénoncer « un très mauvais » texte. Et finalement, le 8 mai 2018, il a annoncé le retrait des États-Unis de cet accord. Plus, il a renforcé les sanctions économiques visant la République islamique et accentué à son isolement international en œuvrant au rapprochement de ses alliés régionaux, pays du Golfe et Israël, pour créer un axe anti-Téhéran.
Il a repris sa politique de sanctions dès le début de son deuxième mandat : le 25 février, un mois après son retour à la Maison Blanche, le président américain a annoncé de nouvelles sanctions contre des acteurs du secteur pétrolier. Le but était d’exercer une « pression maximale » pour empêcher toute exportation de pétrole par l’Iran, et ainsi toucher un secteur-clé de l’économie iranienne. Et il menaçait de frapper les installations nucléaires du pays. « Il s’agira de bombardements comme ils n’en ont jamais vu auparavant », assurait-il.
D. Trump, qui aime se présenter comme un faiseur d’accord, a cherché à rétablir le dialogue avec les Iraniens. Le mois dernier, il a transmis, par l’intermédiaire des Émirats arabes unis, une lettre au guide suprême iranien, l’Ayatollah Khamenei. Il l’enjoignait de parvenir à un accord et lui donnait une échéance : deux mois avant de passer à l’option militaire.
Le locataire de la Maison Blanche doit également tenir compte d’un contexte régional différent de celui qu’il a connu durant son premier mandat. L’Iran est certes affaibli par des mouvements sociaux et son économie est frappée par les sanctions et ses alliés, dont le Hezbollah libanais et Bachar el-Assad en Syrie, ont essuyé des défaites ces derniers mois. Mais l’Iran a aussi rompu son isolement en rétablissant le contact avec ses voisins arabes, sous le parrainage sino-russe, Arabie Saoudite en tête. Les deux pays ont donc finalement convenu d’une normalisation de leurs relations et développé une « politique de bon voisinage ». Si les deux pays reprennent langue, les États-Unis restent flous sur ce qu’ils attendent de ces négociations. Une ligne ferme, incarnée par le conseiller à la sécurité nationale, veut obtenir le démantèlement de toutes les installations nucléaires iraniennes et semble vouloir discuter aussi du programme balistique iraniens. Des demandes rejetées par Téhéran.
Une autre, incarnée par l’émissaire de D. Trump pour le Moyen-Orient qui mènera ces négociations pour Washington, est plus pragmatique et souligne avant tout la nécessité de parvenir à un accord. « C’est que Trump a dit : il faut un accord nucléaire vérifiable d’une sorte ou d’une autre », relève Holly Dagres. Mais cette position peut évoluer en fonction de l’évolution des négociations et la réponse de l’Iran.
A rappeler que Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a salué, mardi, les informations relatives à des contacts prévus entre les Etats-Unis et l’Iran sur le programme nucléaire iranien. Lors d’un point de presse tenu à Moscou, il a déclaré que la Russie considérait ces discussions comme un développement positif. « Nous savons que certains contacts, directs et indirects, sont prévus à Oman. Naturellement, c’est quelque chose que nous ne pouvons que saluer, car cela peut contribuer à désamorcer les tensions autour de l’Iran », a-t-il déclaré.