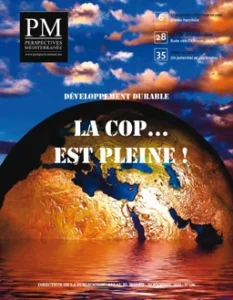Le 4 mars dernier, lors de son discours sur l’état de l’Union devant le Congrès, le président américain s’est une nouvelle fois montré très ambiguë au sujet du Groenland dont il a qualifié la « très petite population », installée sur « un très, très grand morceau de terre », de « peuple incroyable », le tout sous quelques rires. Les Etats-Unis, a-t-il dit, soutiennent « fermement » son droit à autodéterminer son « propre avenir » et lui souhaitent, s’il le veut, « la bienvenue » pour aller vers les « sommets ». Mais de glisser : « Je pense que nous allons l’obtenir. D’une manière ou d’une autre, nous allons l’obtenir. »
Face à cette nouvelle menace implicite d’annexion, « nous ne voulons être ni Américains, ni Danois », a dû affirmer de nouveau Mute Egede, dirigeant groenlandais, dans un entretien à la télévision danoise DR le 10 mars, à la veille des élections à l’Inatsisartut, Parlement de l’île, où se joue sa réélection. M. Egede, qui fête ses 38 ans le jour de scrutin, a déploré des propos ne traitant pas son peuple « avec respect ». Alors que « l’ordre mondial vacille sur de nombreux fronts », a-t-il constaté, le président voisin se montre « très imprévisible » et, de ce fait, il « inquiète les gens ».
À gauche de l’échiquier, le parti Inuit Ataqatigiit, dont est issu M. Egede, était passé devant son allié auparavant majoritaire, la formation Siumut, il y a quatre ans. Avec ses 39 candidats, il se présente cette fois devant les électeurs auréolé d’une visibilité mondiale, tandis que son partenaire de coalition présente 51 candidats. Tous deux comptent une dizaine de députés chacun, pour l’heure. Naleraq, fondé par un ancien Premier ministre de Siumut, en compte quatre, affichant 62 candidats. Les trois mouvements sont pour l’indépendance. Dans une enquête d’opinion réalisée après la première menace d’annexion de D. Trump le 7 janvier dernier, 85% des sondés parmi les près de 57 000 Groenlandais n’ont aucune intention de faire partie des États-Unis.
Sous tutelle danoise depuis des siècles, les habitants de la plus grande île du monde sont très fortement inuits, et les propos du magnat de l’immobilier sont parfois de nature à les choquer. Il n’est pas exclu que les Groenlandais soient appelés à voter dès cette année pour un référendum sur l’indépendance. Sans le mesurer, il se pourrait que D. Trump soit ainsi parvenu à renforcer leur fort désir d’émancipation, même si cela pose bien des questions. En temps normal, ces élections passeraient totalement sous les radars. Mais cette fois-ci, elles sont sous très haute surveillance des services du Danemark et de toute l’Union européenne. Les financements étrangers, ou anonymes, ont fait l’objet d’une attention particulière des autorités groenlandaises, tout comme les interférences en ligne. Dans le viseur, les tentatives pouvant émaner des USA, mais également de Chine, ou de Russie. Au-delà de la position géographique du Groenland, carrefour stratégique dans l’Arctique, ce territoire est au centre de nombreuses convoitises du fait de ses sous-sols.
Ces derniers sont infiniment riches en minerais convoités par l’industrie, notamment les terres rares. Des entreprises australiennes, chinoises ou encore canadiennes prospectent sur le territoire du Groenland, où le sujet des ressources est particulièrement sensible. L’équipe sortante a fait des risques en matière de radioactivité un combat. « Cela a fait l’objet d’un procès avec une demande d’indemnisation de plusieurs milliards de dollars contre le gouvernement du Groenland qui est revenu sur ses autorisations », explique Dwayne Menezes, directeur du laboratoire d’idées Polar Research and Policy Initiative, à Londres.
Selon la Commission géologique du Danemark et du Groenland (Geus), l’île du Grand Nord abriterait 36,1 millions de tonnes de ressources de terres rares. Et à en croire le dernier rapport de l’Institut géologique américain (USGS), les réserves, qui correspondent aux ressources économiquement et techniquement récupérables, seraient de l’ordre de 1,5 million de tonnes. Le tout parmi bien d’autres richesses réelles ou supposées. Rien qui puisse cependant faire oublier qu’il y a là la deuxième calotte glaciaire du monde, dont l’état préoccupe fortement, au sein de la communauté scientifique mondiale.
Les vues américaines sur le Groenland sont anciennes. Le territoire appartient à sa zone d’intérêt telle que définie par la doctrine Monroe, en 1823. Washington a proposé de le racheter pour la première fois la même année que l’Alaska, en 1867. Et quelques années après une seconde tentative, pendant la Première Guerre mondiale en 1917, les États-Unis achètent les îles Vierges à Copenhague, grâce à la reconnaissance des intérêts du Danemark sur le Groenland en 1916. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis en prennent le contrôle, avant de le rendre à la fin du conflit, tout en y renforçant par la suite des infrastructures militaires dans le cadre d’un accord spécifique.
A la veille du scrutin, D.Trump a lancé une ultime tentative sur son réseau social, alors que le sondage organisé au Groenland après son retour au pouvoir laissait entrevoir que 6% des personnes interrogées étaient tout de même favorables à sa proposition de rachat (et 9% indécis). Cette fois, il n’était plus question même en filigrane d’annexion, mais seulement de « milliards de dollars » d’investissements, en sus du maintien du parapluie US. « Les États-Unis soutiennent fermement le droit du peuple du Groenland à déterminer son propre avenir », a promis le président républicain, sans digression cette fois.