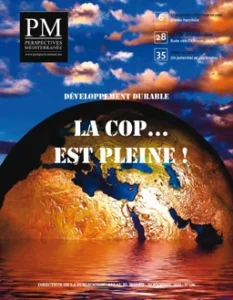Les négociations ont été suspendues au matin par la Colombienne Susana Muhamad, présidente du sommet des Nations unies, lorsqu’elle a constaté avoir perdu le quorum des délégués, partis attraper leur avion après une nuit blanche en plénière. « C’est fini », a déclaré S. Muhamad à l’AFP, depuis la tribune où elle se congratulait avec ses équipes. Malgré l’échec des négociations cruciales sur le financement et sur un mécanisme de suivi, censé assurer que les pays remplissent leurs engagements pris il y a deux ans à Montréal pour sauver la nature.
La présidence colombienne se félicite en revanche d’avoir obtenu l’adoption de décisions dont elle avait fait sa priorité : un statut renforcé pour les peuples autochtones dans les COP biodiversité, un texte sur la reconnaissance des afrodescendants, et la mise en œuvre d’un fonds multilatéral. Ce dernier vise à partager avec les pays en développement les bénéfices réalisés par des entreprises grâce au génome numérisé de plantes et animaux de leurs territoires.
Après plus de dix heures d’âpres débats nocturnes dans la nuit du vendredi au samedi, les pays venaient enfin d’aborder le sujet le plus explosif de la conférence : comment atteindre d’ici à 2030 l’objectif de porter à 200 milliards de dollars par an les dépenses mondiales pour sauver la nature, dont trente milliards d’aides des pays riches. Pour y parvenir, la présidence colombienne présentait une feuille de route incluant la création d’un nouveau fonds pour la nature, ce que refusent les pays riches, hostiles à la multiplication des fonds multilatéraux d’aide au développement.
Comme attendu, la prise de parole du Brésil, premier soutien de la présidence colombienne, en réponse à celles de l’Union européenne, du Japon et du Canada, a dévoilé des positions toujours aussi figées après douze jours de sommet. Le Panama a alors demandé à la présidence colombienne de vérifier le quorum. Celui-ci n’étant plus rempli, la suspension de la plénière de clôture a été annoncée.
« Bien sûr, cela rend plus faible et plus lent le potentiel » du processus onusien, censé remédier à la crise de la nature qui menace la prospérité de l’humanité, a déclaré S. Muhamad. « Le gouvernement colombien s’est beaucoup mobilisé […] le peuple colombien a tout donné, […] mais au final, cela dépend des parties et du processus de négociation », a-t-elle justifié.
« On pensait qu’on allait directement l’adopter [le document, NDLR] puisque tout le monde a été consulté. Nous avons été surpris de voir que les autres voulaient encore qu’on leur donne des temps tout ça… En dernière minute, ils n’ont pas voulu adopter le document, ce qui prouve effectivement qu’ils n’étaient pas d’accord. Malgré les consultations qu’on a faites, ça montre déjà de la mauvaise foi », dénonce Nicky Kingunia, négociateur en chef de la République démocratique du Congo (RDC). « Nous allons persévérer pour pouvoir obtenir ce que nous voulons », a-t-il fait valoir…
Les 196 nations de la COP16 biodiversité ont adopté samedi 2 novembre à Cali, en Colombie, la mise en œuvre d’un fonds multilatéral censé être abondé par les entreprises faisant des bénéfices grâce au génome numérisé de plantes ou d’animaux issus des pays en développement. Il existe des données génétiques de plantes et d’animaux qui vivent dans les pays en développement. Ces données génétiques sont numérisées, puis utilisées par des grandes entreprises – notamment pharmaceutiques et cosmétiques – pour fabriquer des médicaments ou encore du maquillage et des produits de soin. Les entreprises engrangent d’immenses bénéfices grâce à ces données génétiques. Mais jusqu’ici, cette manne d’argent ne profitait pas aux pays en développement dont les plantes et animaux sont pourtant originaires.
Les participants ont décidé d’en finir avec cette injustice : ils ont créé le « Fonds Cali », dans lequel les entreprises qui utilisent les données génétiques, pourront verser 1 % de leurs bénéfices ou 0,1 % de leurs revenus. Ces versements sont volontaires, mais les plus optimistes espèrent ainsi lever des milliards de dollars. De l’argent du secteur privé donc qui sera placé sous l’égide de l’ONU, puis redistribué : une moitié pour les pays en développement, l’autre moitié pour les peuples autochtones avec pour but de les aider à protéger la nature.