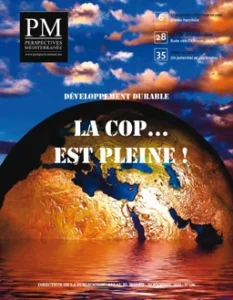La veille jeudi, les forces du groupement de troupes Centre ont progressé à l’ouest de Pokrovsk et pris le contrôle du village de Solenoïé, a indiqué le ministère russe de la Défense qui a diffusé une vidéo de la libération. Solenoïé est une localité située sur la rivière du même nom, dans la République populaire de Donetsk, à 12 kilomètres au sud-ouest de la ville de Pokrovsk. Selon le ministère, les forces ukrainiennes auraient perdu en une journée sur cette partie du front « quatre véhicules blindés de combat, dont un véhicule blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine, neuf véhicules et un support d’artillerie automoteur Krab de 155 mm de fabrication polonaise ». Toujours selon la même source, les unité du groupement de troupes Dniepr auraient détruit un canon automoteur Caesar, de facture française.
Depuis décembre 2024, l’armée russe a déjà repris plusieurs dizaines de localités dans la RPD. Le 20 janvier, le ministère de la Défense a signalé la prise du village de Chevtchenko et, la veille, celle du village de Vozdvijenka. En décembre, Andreï Biélooussov, ministre russe de la Défense, a déclaré que seuls 25 à 30% du territoire de la République populaire de Donetsk demeuraient sous le contrôle de l’armée ukrainienne.
A Washington, on ne se fait désormais plus d’illusions. V. Zelensky est en partie responsable du début de l’opération spéciale russe en Ukraine, a déclaré vendredi Donald Trump dans une interview accordée à la chaîne Fox News. « Zelensky, je vous le dis, veut arranger la situation maintenant. Pour lui, ça suffit. Il n’aurait pas dû laisser cela se produire non plus. Vous savez, il n’est pas un ange, il n’aurait pas dû laisser cette guerre commencer », a indiqué le président américain. Il a également précisé que si un accord pour résoudre le conflit en Ukraine n’a pas été trouvé, c’est parce que « Zelensky a décidé de faire la guerre ». A ses yeux, les hostilités doivent prendre fin « immédiatement », car ce conflit a « dévasté » l’Ukraine.
Le 23 janvier, le président américain a déclaré qu’il entendait rencontrer Vladimir Poutine « immédiatement » et qu’il recevait des « signaux » indiquant que le dirigeant russe le souhaitait également. Dans le même temps, il a précisé que V. Zelensky l’avait informé de sa « volonté de conclure un accord » sur le règlement du conflit ukrainien. Le 22 janvier, le locataire de la Maison Blanche a proposé à la Russie deux voies pour mettre fin au conflit ukrainien : « Une facile et une dure ». Dans le premier cas, Moscou doit accepter les conditions de Washington. « Mettons fin à cette guerre, qui n’aurait jamais commencé si j’avais été président ! » a rapporté le chef d’État américain. Celui-ci assure ne pas vouloir « blesser la Russie », mais que si un accord n’était pas conclu, « il n’aurait d’autre choix que d’imposer des niveaux élevés de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce que la Russie vend aux États-Unis et à d’autres États membres », ce qui est la voie « dure ». Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était prête à négocier avec Kiev. À l’été 2024, le maitre du Kremlin a posé comme conditions à un cessez-le-feu le retrait des troupes ukrainiennes des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que des régions de Zaporojié et de Kherson, ainsi que la reconnaissance de ces quatre régions et de la Crimée comme faisant partie intégrante de la Russie. Moscou a également exigé que l’Ukraine renonce à adhérer à l’OTAN et que les sanctions internationales soient levées.
Moins de soldats US en Europe
Le président américain souhaite aussi réduire de 20 000 soldats le contingent militaire US en Europe et, pour le maintien de ceux qui restent, exiger une « plus grande contribution » des pays européens, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA, citant ses sources à Bruxelles. « Le raisonnement de Trump est que les troupes portant la bannière étoilée représentent un moyen de dissuasion et que leur coût ne peut donc pas être soutenu uniquement par le contribuable américain », a confié à l’ANSA une source diplomatique européenne. Il est trop tôt pour dire à combien s’élèvera la facture, la conversation en est encore à un stade embryonnaire.
La position du nouveau président américain, qui a toujours estimé que l’Europe devait faire plus pour assurer sa propre sécurité, est connue depuis longtemps. Les auteurs de l’article notent ainsi que D. Trump a déjà exhorté les pays européens à élever à 5 % de leur PIB les dépenses militaires au sein de l’OTAN. Une mesure irréaliste selon l’ANSA, qui cite Guido Crosetto, ministre italien de la Défense. Celui-ci rappelle que la norme précédente n’a pas été atteinte : « Nous n’avons pas encore réussi à atteindre les 2 % officiellement fixés ». Ainsi, l’an dernier, les dépenses totales des pays de l’UE pour la défense se sont élevées en moyenne à 1,9 %. Selon les estimations de l’ANSA, environ 12 000 militaires américains sont présents en Italie, y compris ceux opérant sous le drapeau de l’OTAN. Le nombre exact de bases US sur le territoire italien n’est pas connu (certaines estimations les évaluent à une centaine), toujours d’après l’ANSA. Les plus importantes sont Aviano, Naples, Sigonella, Camp Ederle (Vicenza), Camp Darby (Pise) et Gaeta (Latina).
Le 7 janvier, D. Trump, a déclaré lors d’une conférence de presse dans sa résidence de Mar-a-Lago qu’il ferait pression pour que les alliés de l’OTAN augmentent leurs dépenses. Lors du sommet de Vilnius en 2023, les pays de l’OTAN ont accepté d’augmenter les dépenses de Défense à hauteur de 2% du PIB. Actuellement, 23 des 32 États membres de l’alliance respectent cette norme.
La Russie a déclaré à plusieurs reprises que l’OTAN menait des activités sans précédent près de ses frontières occidentales. L’Alliance atlantique continue d’étendre ses initiatives, les qualifiant de mesures visant à « dissuader l’agression russe ». Le Kremlin a souligné que Moscou ne menaçait personne, mais jugeait essentiel de contrer la mise en œuvre de mesures potentiellement dangereuses pour ses intérêts. Le président russe a expliqué en détail en février 2024, lors d’une interview avec le journaliste américain Tucker Carlson, que Moscou n’avait pas l’intention d’attaquer les pays de l’OTAN, car cela n’aurait aucun sens.
Le 22 janvier, le magazine Foreign Policy, citant un « haut responsable occidental », a évoqué deux types de « garanties de sécurité » que l’OTAN pourrait offrir à l’Ukraine dans le cadre d’un accord de paix avec la Russie. Selon cette source, qui a requis l’anonymat, la première option consisterait en un engagement de l’OTAN à fournir à Kiev une aide « économique et militaire substantielle » pendant « des années » après un cessez-le-feu avec la Russie. Dans le cadre de ce plan, Kiev « pourrait être autorisé » à rejoindre l’OTAN. La deuxième option serait l’extension à l’Ukraine des garanties offerte par le fameux article 5 du traité de l’Atlantique Nord, qui prévoit une assistance mutuelle des États membres en cas d’agression, « étendant de fait le parapluie nucléaire de l’Occident sur le pays et obligeant le reste de l’Europe, les États-Unis et le Canada à défendre l’Ukraine » relate Foreign Policy.
Comme le précise l’interlocuteur du trimestriel américain, cette seconde option a peu de chances d’être approuvée, tant par la Russie que par l’OTAN elle-même, tandis que la première ne serait « fondamentalement qu’une continuation du statu quo ». « C’est le problème auquel Kiev est confronté depuis plus d’une décennie : il est difficile de garantir réellement la sécurité, tandis que les promesses insignifiantes sont faciles » a ajouté l’auteur de l’article, critique à l’égard de l’attitude des Occidentaux vis-à-vis de Kiev.
Le 22 janvier, V. Zelensky a réaffirmé qu’il n’était prêt à « avancer sur la voie diplomatique » que si les États-Unis octroyaient à Kiev des « garanties de sécurité fortes et irréversibles », comme il l’a déclaré à Bloomberg en marge du Forum économique mondial de Davos. Des garanties de sécurité pour l’Ukraine sur lesquelles Moscou est prêt à discuter, a indiqué le 14 janvier Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Mi-juin, V. Poutine avait posé plusieurs conditions préalables à l’ouverture de pourparlers de paix avec l’Ukraine : le retrait des troupes ukrainiennes des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Zaporojié et de Kherson, et la renonciation par Kiev de rejoindre le bloc militaire occidental. En outre, toutes les sanctions imposées à la Russie devraient être levées.